L'invit� de la semaine
derni�re : Yanomi De
Oliveira
LES
INVITES DU COSMOPIF
N�163 (lundi 17 septembre 2007)
Jean-Jacques Favier
Premier astronaute
scientifique fran�ais
Directeur adjoint de la
Prospective et de la Strat�gie
� la Direction des
Programmes du CNES

Jean-Jacques Favier en bref
Ing�nieur INPG, Docteur Ing�nieur, Docteur �s Sciences
Sixi�me astronaute fran�ais (sujet de l'espace
n�349)
Candidat astronaute du CNES en 1985 et sp�cialiste de
mission de la NASA en 1992
N� le 13 avril 1949 � Kehl (Allemagne)
Mari�, 4 enfants
Un vol spatial � son actif : mission
LMS/Columbia STS-78 (16 jours 21 heures et 48 minutes).


Parcours
professionnel
Ing�nieur en �lectrom�tallurgie de l'Institut
polytechnique de Grenoble en 1971, Jean-Jacques Favier obtient un DEA de
physique du solide en 1972, le doctorat d'ing�nieur � l'Ecole des Mines de
Paris en 1976 et un doctorat �s sciences en M�tallurgie physique � l'Universit�
de Grenoble en 1977. Il travaille � partir de 1976 au Centre de Grenoble du
Commissariat � l'Energie Atomique, o� il est successivement chef du laboratoire
d'�tudes de la solidification puis Chef de service mat�riaux et g�nie des
proc�d�s du Centre d'�tudes et de recherches sur les mat�riaux (CEREM). Il
propose une dizaine d'exp�riences de m�tallurgie et de cristallogen�se en
micropesanteur dont il est le responsable scientifique. Il est en particulier �
l'initiative du programme franco-am�ricain MEPHISTO d'�tude de la
solidification d'alliages en micropesanteur qui est embarqu� �
quatre reprises � bord de la navette spatiale am�ricaine entre 1992 et
1997.
Jean-Jacques Favier est s�lectionn� comme astronaute
"exp�rimentateur" par le CNES en septembre 1985 et retenu par la NASA
en septembre 1992 comme suppl�ant de la Japonaise Chiaki Mukai,
choisie pour participer � la 2e mission de recherche internationale
IML (International Microgravity Laboratory) � bord du laboratoire Spacelab qui
sera install� dans les soutes de la navette Columbia en juillet 1994 (mission
STS-65). Mis � la disposition du CNES par le CEA, il rejoint le centre Johnson
de Houston pour suivre une formation de sp�cialiste de charge utile. Durant la
mission STS-65 de 14 jours, il assure le r�le de Crew Interface
Coordinator, l'interface entre les astronautes en orbite et les scientifiques
regroup�s au Marshall Space Flight Center de Huntsville (Alabama).

Le centre de
contr�le des charges utiles du centre Marshall � Huntsville
NASA
En 1995, Jean-Jacques Favier est d�sign� sp�cialiste charge utile pour la
mission LMS (Life and Microgravity Sciences) du vol STS-78 de la navette Columbia,
qui se d�roule du 20 juin au 7 juillet 1996. Il devient le premier
scientifique fran�ais de l'espace. La dur�e atteinte par la navette (pr�s de
17 jours) reste un record jusqu'en novembre 1996 (mission STS-80).


L'�quipage de la mission LMS
au sol avant la mission et en vol.
Sur la seconde photo, en
partant de Susan Helms (commandant de la charge utile) en haut au milieu
et en tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre, on trouve Jean-Jacques Favier,
Bob Thirsk (sp�cialiste de charge utile), Kevin Kregel (pilote),
Charles Brady (sp�cialiste de mission),
Richard Linnehan (sp�cialiste de mission) et Tom Henricks (commandant).
NASA
Nomm� Directeur de Recherche au Commissariat �
l'Energie Atomique (CEA) de Grenoble et Charg� de mission aupr�s du Haut
Commissaire du CEA en 1997, Conseiller du Directeur des Technologies avanc�es
du CEA jusqu'en 1999, Jean-Jacques Favier �tudie les synergies possibles entre
le CNES et le CEA et coordonne les recherches spatiales du CEA. Il rejoint le
CNES � Toulouse en 1999, en tant que Directeur adjoint des Techniques
spatiales, responsable de l'animation des centres de comp�tences techniques. Il
poursuit �galement la coordination des relations entre le CNES et le CEA.
Il est auteur ou co-auteur de 130 publications scientifiques.
D�corations,
distinctions et autres titres
Chevalier de la L�gion d'honneur, titulaire de la
Grande M�daille des astronautes de la NASA (Space Flight Medal), de la Grande
M�daille de la ville de Grenoble, du second Prix Zellidja de l'Acad�mie
fran�aise en 1970, du Prix E. Brun en 1985 puis du Grand Prix Marcel Dassault
de l'Acad�mie des Sciences en 1997.
Membre de l'American Association of Crystal Growth, de
la Soci�t� Ffran�aise de m�tallurgie, du Groupe Fran�ais de Croissance
Cristalline, Professeur invit� de l'Universit� de l'Alabama � Huntsville,
membre du Comit� de science spatiale de l'European Science Foundation, Chairman
du Space Station User Pannel de l'ESA.
Loisirs
Ski, v�lo, tennis, voile et arch�ologie.
7 questions
� Jean-Jacques Favier

Photo Laurent
Aznar
Jean-Jacques
Favier, comment est n�e votre vocation
pour l'espace ?
La naissance de ma vocation pour
l'espace est tr�s pr�cise : Youri Gagarine a vol� la veille de mes
12 ans, le 12 avril 1961, et mes parents m'ont offert pour mon
anniversaire le lendemain le livre de Jules Verne "Le tour du monde en
80 jours" avec une petite d�dicace disant : "Tu feras partie
de la g�n�ration qui le fera en 80 minutes" : c'�tait tr�s
pr�monitoire !


Le vol de Gagarine m'a donc marqu�
pour toute la vie m�me si je ne pensais jamais faire partie d'une telle
aventure. J'ai bien voulu �tre pilote � un moment mais j'ai trop grandi et mon
cursus professionnel m'a un peu �loign� du domaine. Cependant, quand j'ai pu me
rapprocher du spatial et des vols habit�s, j'ai tent� aussit�t ma chance. J'ai
ainsi pu �tre recrut� en 1985 dans la deuxi�me classe d'astronautes du CNES,
aux c�t�s de Claudie Andr�-Deshays, Jean-Fran�ois
Clervoy, Jean-Pierre Haigner�,
Fr�d�ric Patat (qui s'est retir�), Michel Tognini
et Michel Viso.

La s�lection
1985 de spationautes du CNES.
De gauche �
droite : Jean-Fran�ois Clervoy, Claudie Andr�-Deshays, Jean-Jacques Favier,
Jean-Pierre
Haigner�, Fr�d�ric Patat, Michel Tognini et Michel Viso.
CNES
C'est amusant de voir que, malgr�
tous les tests auxquels j'avais du me soumettre, il avait �chapp� aux
examinateurs que j'�tais trop grand pour le Soyouz. Mais, d�s ma premi�re
visite � la Cit� des �toiles, force �tait de constater que je ne pouvais pas
rentrer dans le si�ge (qui a �volu� depuis). J'ai donc concentr� mes efforts
sur la navette am�ricaine et ai attendu 11 ans avant d'effectuer mon vol.
Comme quoi, la t�nacit� doit �tre la premi�re qualit� d'un astronaute�


Lancement
et retour de la navette Columbia lors de la mission STS-78
NASA
Comment
devient-on le premier scientifique fran�ais de l'espace ?
Apr�s cette s�lection de 1985,
j'avais continu� ma carri�re de chercheur au CEA. L'avantage �tait que je ne
tournais pas en rond et que j'avais un travail qui m'int�ressait. Mais
l'inconv�nient �tait d'�tre un peu �loign� des processus d'affectation quand
une opportunit� de faire voler un astronaute fran�ais se pr�sentait. J'ai donc
d�cid� d'aller prendre quelques mois sabbatiques au centre Marshall de la NASA
� Huntsville en 1992 et la chance a voulu qu'une s�lection de sp�cialistes de
mission soit lanc�e au m�me moment. Je me suis pr�sent� sur place et suis
arriv� dans le peloton de t�te. La Japonaise Chiaki Mukai, tr�s
soutenue par son agence, a �t� d�sign�e titulaire pour la mission IML-2
(STS-65) et j'ai �t� retenu pour lui servir de doublure. Mon patron de
l'�poque, Yannick d'Escatha (aujourd'hui pr�sident du CNES), m'a alors autoris�
� rester aux Etats-Unis pour pr�parer et suivre cette mission :
deux ans dans le Saint des Saints, une exp�rience extraordinaire que je ne
pouvais pas rater.


Le
commandant de la mission STS-65 Richard Hieb (� gauche), Jean-Jacques Favier
(au centre)
et
la Japonaise Chiaki Mukai se familiarisent chez Boeing avec des �quipements
qui
seront embarqu�s � bord de la navette Columbia en juillet 1994.
NASA
Durant le vol, la NASA
m'a confi� le r�le de Crew Interface Coordinator (CIC/APS) depuis le centre de
contr�le du centre Marshall, charg� des communications avec l'�quipage pour les
exp�riences men�es � bord du Spacelab (je suis le premier non-Am�ricain � avoir
tenu ce r�le). L'exp�rience fut passionnante, j'ai pass� des heures et des
heures au centre de contr�le, connaissant bien l'�quipage qui volait,
connaissant bien les exp�riences embarqu�es et les scientifiques qui les
suivaient. Je dormais quasiment sur place et avais l'impression de faire partie
de la mission. La seule diff�rence avec mes coll�gues, c'est que je n'�tais pas
en �tat de micropesanteur !
Apr�s ce vol, mon contrat avec la
NASA se terminant, j'ai demand� � rencontrer George Abbey, le directeur du centre
de la NASA � Houston (la terreur des astronautes), pour lui demander conseil.
Il m'a re�u et m'a invit� � revenir le voir 15 jours plus tard. L�, il m'a
dit : "Restez aux Etats-Unis". J'ai compris que, l� peut-�tre,
j'avais une chance de pouvoir voler [Rires]. J'ai donc trouv� un poste de
professeur associ� � l'Universit� pour patienter ; 6 mois plus tard,
George Abbey me rappelait pour m'annoncer que j'�tais titulaire pour la mission
Life and Microgravity Spacelab, sur STS-78. Une
s�lection qui n'a pas co�t� un sou au CNES puisque j'�tais invit� gracieusement
par la NASA (l'entra�nement des astronautes europ�ens est aujourd'hui factur�)
et toujours pay� par le CEA.


Jean-Jacques
Favier avant le lancement de Columbia puis en vol
NASA
Je suis rest� aux
Etats-Unis jusque fin 1996, faisant alors le choix de rentrer en France en
famille (mes enfants seraient bien rest�s�). Rendez-vous compte que, si j'�tais
rest�, le vol STS-107 �tait la suite de ma mission ! Le Spacehab avait
remplac� le Spacelab mais c'�tait les m�mes exp�riences. Je connaissais tr�s
bien l'�quipage (le commandant Rick Husband avait notamment �t� l'ange gardien
de ma famille durant mon vol). L'accident de Columbia a donc �t� un tr�s grand
choc.
J'aurais bien aim�
effectuer un second vol, peut-�tre pour en profiter davantage � titre
personnel. J'ai en effet essay� d'�tre le plus professionnel possible, tout
comme les Am�ricains qui donnent le meilleur d'eux-m�mes durant la mission
("do the best job"). Aucun astronaute am�ricain ne vole pour faire la
vedette et d'ailleurs tous acc�dent � des postes de responsabilit� quand ils
quittent le corps des astronautes. C'est assez culturel.

Philippe
Perrin succ�de � Jean-Jacques Favier � l'entra�nement � Houston en 1996
Quel
souvenir marquant souhaitez-vous nous relater ?
Le choix est difficile,
les souvenirs sont fort nombreux. Plusieurs choses m'ont en tous cas surpris
durant l'entra�nement.
D'abord, je pensais que
pour �tre astronaute, il fallait vraiment �tre exceptionnel, avoir une sant� de
fer et �tre quasiment un sportif de niveau olympique. Ce n'�tait �videmment pas
le cas pour moi, m�me si je pratiquais du sport r�guli�rement. Or quand j'�tais
� la NASA, nous �tions 140 et je peux vous dire qu'il y avait tous les profils,
m�me des petits bedonnants. On est davantage jug�s sur notre capacit� �
int�grer un certain nombre d'informations tr�s vite, comprendre vite, anticiper
et l'entra�nement y contribue �norm�ment.
Il y a ensuite tous les aspects de
psychologie, individuelle et collective, auxquels la NASA est tr�s attentive.
Passer devant un psychologue, c'est d�j� pas marrant en France mais, quand il
s'agit de raconter votre petite enfance ou vos petits probl�mes � un Texan,
c'est encore moins �vident ! [Rires]
J'en enfin appr�ci� le fait que
l'entra�nement �tait � la fois tr�s structur� et laissait un certain volant de
libert� dans l'accomplissement des diff�rentes �tapes. Pour �tre qualifi�
astronaute, il faut ainsi passer l'�quivalent d'unit� de valeur (environ
110 tests), comme � la fac, que vous pouvez rater et repasser plus tard.
Il y a ainsi plusieurs t�ches autour des syst�mes informatiques, des syst�mes
hydrauliques, de la m�canique, etc. et chacune doit �tre ma�tris�e dans un laps
de temps d�fini avant le vol (entre 15 et 12 mois pour l'informatique,
entre 12 et 9 mois pour l'hydraulique). Sur cette base, vous faites donc
vous-m�me votre programme et vous vous organisez par quinzaine avec le coach de
votre �quipe. Chaque unit� de valeur comprend un cours th�orique (en classe,
sur polycopi� ou par travail personnel sur ordinateur) et des travaux pratiques
(tests sur simulateurs). Cependant, plus on se rapproche du vol, plus cette
libert� d'organisation de son entra�nement se r�duit, notamment du fait des
s�ances communes de tout l'�quipage en simulateur.

Les sp�cialistes de charge utile de la mission LMS
� l'entra�nement en 1995 :
le Canadien Bob
Thirsk (� gauche), Jean-Jacques Favier (au fond),
le Belge Vladimir Pletser
(au centre) et l'Italien Luca Urbani
Quelle
photo de la conqu�te spatiale retiendriez vous ?
L'�v�nement qui m'a le plus remu�,
c'est sans conteste Armstrong sur la Lune en juillet 1969. Nous n'avions pas la
t�l�vision � la maison, comme la moiti� des Fran�ais � l'�poque, mais je l'ai
vu en direct chez mon oncle. C'�tait une tr�s belle nuit d'�t� durant laquelle
on voyait tr�s bien la Lune et je passais mon temps � sortir dehors � la
regarder et en pensant "Quand m�me, il y a un mec qui marche
l�-haut". C'�tait vraiment un moment exceptionnel, un grand saut pour
l'humanit�.
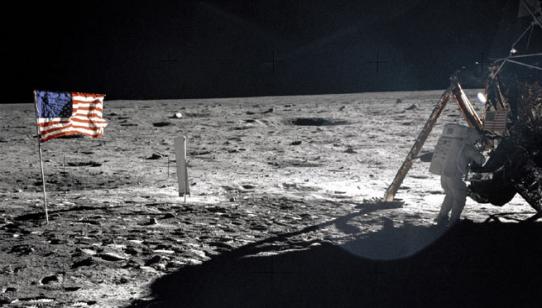
De la m�me
mani�re, quel objet spatial retiendriez-vous ?
Il y a �galement tout un spectre
de r�ponses possibles mais je pense que c'est la fus�e Saturn 5 - je ne
dois pas �tre le seul � r�pondre cela [Rires] - La navette, c'est vraiment tr�s
beau, c'est unique et grandiose mais Saturn 5, c'est inou�. Ses dimensions
sont extraordinaires ; on peut faire le tour des trois qui restent et, �
chaque fois, je me demande comment une telle masse a pu d�coller. Et puis son
d�veloppement en 8 ans reste unique, je ne sais pas si on conna�tra un
jour un tel engouement pour le spatial�

Assemblage
d'une fus�e lunaire dans le VAB de Cap Kennedy
NASA
Quel serait
votre r�ve spatial le plus fou ?
Je m'efforce aujourd'hui � ce que
les vols habit�s continuent � avoir leur place dans le programme spatial
europ�en, dans la perspective pour le si�cle qui vient du d�barquement de
l'homme sur Mars.

Vue
d'artiste du programme d'exploration Aurora de l'Agence spatiale europ�enne
ESA
Que repr�sente
pour vous la station Mir ?
En tant que scientifique, avec mon
laboratoire du CEA � Grenoble, j'ai fait voler pas mal de manips sur les
stations russes. En 1978, j'ai �t� le premier scientifique europ�en � faire
voler des exp�riences sur Saliout-6. En 1982, j'avais travaill� sur le vol de
PVH de Jean-Loup Chr�tien � bord de Saliout-7.
Merci, Jean-Jacques Favier !
Interview r�alis�e
au Centre spatial de Toulouse le 6 juillet 2007
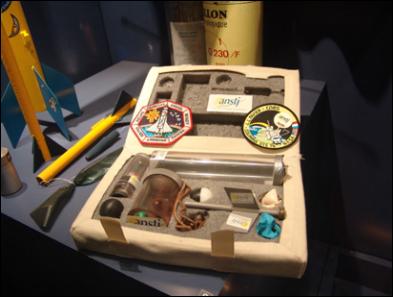
Mallette
p�dagogique "Poids Coq" �labor�e par l'ANSTJ (ex-Plan�te Sciences)
et
embarqu�e par Jean-Jacques Favier � bord de Columbia en juin 1996.
Elle est
aujourd'hui expos�e au Mus�e de l'Air et
de l'Espace.
La semaine
prochaine (lundi 24 septembre 2007) : Nicolas Pillet
Les coordonn�es des invit�s ne sont communiqu�es en
aucun cas